2025/09/04 - Financement de la prime « Ségur » pour les services des mandataires judiciaires à la protection des majeurs - Question de M. Pierre Barros (Sénat) - Date de la question : 21 août 2025 – Date de la réponse : 4 septembre 2025
La question porte sur les moyens et le calendrier de mise en oeuvre de la compensation de la prime « Ségur » par l'État envers les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
Question
M. Pierre Barros attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur la situation préoccupante des services des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Par l'arrêté du 20 juin 2024, le Gouvernement a permis l'octroi de la prime « Ségur », rétroactive au 1er janvier 2024, à tous les professionnels de la branche qui n'en bénéficiaient pas, et s'est engagé à la financer. Les services et associations tutélaires en charge de la protection des majeurs ont versé la prime « Ségur » à l'ensemble des salariés concernés, dont le montant devait être compensé par l'État.
Malgré les engagements du Gouvernement et les promesses de compensation budgétaire, les services et associations tutélaires sont toujours en attente de la compensation de 32 millions d'euros en 2024, auxquels s'ajoute désormais la compensation attendue de 2025, soit un total de 64 millions d'euros.
Cette situation menace la pérennité des structures qui accompagnent plus de 450 000 personnes protégées au niveau national, notamment dans le département du Val-d'Oise. Il devient urgent que le Gouvernement tienne ses promesses. Il lui demande à ce titre de bien vouloir lui indiquer les moyens et le calendrier de mise en oeuvre de la compensation de la prime « Ségur » par l'État envers les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
Réponse
L'attractivité des métiers des secteurs sanitaire, social et médico-social constitue une priorité inscrite au coeur de la feuille de route gouvernementale. Les professionnels du secteur ont bénéficié de revalorisations à hauteur de 4 milliards d'euros qui ont été pris en charge par les financeurs de la branche en partenariat avec l'Etat et les conseils départementaux. Cette mesure a bénéficié à près de 700 000 salariés, dont environ 500 000 dans le cadre des dispositifs issus du Ségur de la santé et de la mission Laforcade, avec une revalorisation mensuelle nette de 183 euros. À la suite de la conférence des métiers sociaux du 18 février 2022, ces revalorisations ont été étendues à 200 000 professionnels de la filière socio-éducative. Ces mesures successives ont contribué à renforcer considérablement l'attractivité d'un secteur qui en avait grandement besoin. L'accord du 4 juin 2024 vient poursuivre cette dynamique en étendant le bénéfice du Ségur à l'ensemble des personnels de la branche associative sanitaire, sociale et médicosociale. Consciente de son rôle clé en tant que principal financeur des Etablissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS), la branche autonomie a d'ores et déjà engagé un financement de 300 millions d'euros dès juillet 2024 pour assurer la mise en oeuvre de cet accord. La prise en charge des coûts induits par cette extension au sein des ESSMS financés par les programmes budgétaires de l'État constitue également une priorité. À cet égard, l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles prévoit expressément que « les conventions ou accords agréés s'imposent aux autorités compétentes en matière de tarification » des ESSMS à but non lucratif, garantissant ainsi une prise en compte obligatoire de ces nouvelles dispositions. Le Gouvernement est pleinement conscient de l'importance du versement de la prime Ségur aux professionnels des associations tutélaires. Aussi, les budgets des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs, qui sont les établissements et services sociaux et médico-sociaux les plus représentés au sein de ce réseau, connaissent en 2025 une progression nationale moyenne de l'ordre de 6%. Les crédits, qui seront alloués prochainement aux directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités dans le cadre de l'instruction budgétaire, comprennent bien le financement du Ségur pour tous.
- Vues: 34
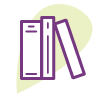 Bibliothèque
Bibliothèque